Bufo bufo, mon crapaud ! 699
Bufo bufo, mon crapaud ! 699
 Il nous arrive fréquemment de découvrir des crapauds dans les cavités visitées, tout particulièrement dans les carrières et souterrains, et, le plus souvent, au fond des puits d’aérage ou d’extraction, là où un peu de lumière solaire persiste à parvenir et où une relative humidité se maintient.
Il nous arrive fréquemment de découvrir des crapauds dans les cavités visitées, tout particulièrement dans les carrières et souterrains, et, le plus souvent, au fond des puits d’aérage ou d’extraction, là où un peu de lumière solaire persiste à parvenir et où une relative humidité se maintient.
Mais aussi parce que le substrat de ces endroits particuliers souvent terreux, feuillé, finit par donner naissance à un biotope où se constitue une chaîne alimentaire…et notre Crapaud commun est un gourmand !
L’un d’entre eux nous plaît bien car nous le rencontrons à chacune de nos visites, au fond du même puits, dans lequel il tomba un jour…13 mètres !
C’est lui, ci contre…!
Du fait de la plasticité de son organisme, du moelleux relatif du tertre d’humus, mais aussi de la pente de celui-ci, évitant la collision frontale absolue, il a pu résister au choc selon toute apparence.
Et depuis quelques années, il est là notre crapaud préféré…On le surnomme Buf(fal)o-bill !
Mais cet article se veut sérieux, et désireux de présenter Bufo bufo comme il le mérite.
Nous remercions la banque de données naturalistes DORIS pour les multiples connaissances qu’elle nous a apportées.
Le reconnaître…

 Le dos est recouvert de verrues très marquées un peu obliques, les yeux ont une pupille horizontale et l’iris est doré à cuivré, plus ou moins visible selon l’éclairage ambiant et les individus
Le dos est recouvert de verrues très marquées un peu obliques, les yeux ont une pupille horizontale et l’iris est doré à cuivré, plus ou moins visible selon l’éclairage ambiant et les individus
Il y a des glandes parotoïdes volumineuses et légèrement obliques, mais pas de sac vocal
Ses orteils sont largement palmés.
Où le rencontrer ?
Il vit sur terre et ne rejoint l’eau que pendant la brève période de reproduction. Il reste pendant la journée dans un trou naturel (sous des pierres, dans des trous ou fissures de murailles) ou creusé par ses soins.
La nuit, il part en chasse et on peut le rencontrer très loin des plans d’eau.
 Bufo bufo est le plus grand des crapauds d’Europe et le plus commun, massif, court sur pattes et trapu, 8 à 10 cm pour les mâles, 10 à 15 cm pour les femelles .
Bufo bufo est le plus grand des crapauds d’Europe et le plus commun, massif, court sur pattes et trapu, 8 à 10 cm pour les mâles, 10 à 15 cm pour les femelles .Outre ses iris cuivrés-dorés et sa pupille quasi horizontale, son museau est arrondi.
Sur la face dorsale, la peau est sèche et recouverte de pustules ressemblant à des verrues. Il s’agit de glandes sécrétant un mucus permettant de préserver l’hydratation et l’élasticité de son épiderme.
La couleur de sa face dorsale varie beaucoup : grisâtre, verdâtre, brunâtre
Elle est uniforme avec parfois, chez les populations méridionales, la présence de quelques taches sombres sur le haut des flancs.
Présentes juste derrière les yeux, les glandes parotoïdes sont volumineuses et s’écartent vers l’arrière (légèrement obliques).
Le crapaud commun a quatre doigts à la main et cinq au pied dont les orteils sont presque entièrement palmés.
Il n’a pas de sac vocal.
Le mâle a des callosités nuptiales (excroissances noirâtres et rugueuses) sur les 3 premiers doigts, particulièrement visibles pendant la période de reproduction.
Bufo bufo est une espèce nocturne sauf pendant la période de reproduction.
 Le têtard de Bufo bufo se distingue de ceux des autres espèces par :
Le têtard de Bufo bufo se distingue de ceux des autres espèces par :– l’extrémité de la queue arrondie ;
– le bord de la nageoire supérieure atteint juste l’extrémité du tronc ;
– il forme des bancs, se déplace de manière synchrone et ne fuit pas lorsqu’on lui fait ombrage.
 Bufo bufo chasse à l’affût dès le crépuscule et pendant la nuit. Son œil voit très bien dans l’obscurité grâce à sa pupille horizontale très extensible. Il se nourrit principalement d’insectes divers et de petits animaux (limaces, vers de terre, chenilles, cloportes, mille-pattes, petits coléoptères, etc…) qu’il attrape en projetant sa langue collante avant de les ramener vers sa bouche.
Bufo bufo chasse à l’affût dès le crépuscule et pendant la nuit. Son œil voit très bien dans l’obscurité grâce à sa pupille horizontale très extensible. Il se nourrit principalement d’insectes divers et de petits animaux (limaces, vers de terre, chenilles, cloportes, mille-pattes, petits coléoptères, etc…) qu’il attrape en projetant sa langue collante avant de les ramener vers sa bouche.Il mastique sa proie en l’écrasant avec le palais.
Quand il mange, ses yeux se ferment et rentrent dans sa tête.
Il a été étudié que Bufo bufo peut s’attaquer aux abeilles, avec des désagréments variables, mais qu’il a du mal à « apprendre » que ce n’est pas la proie idéale pour lui !
 Suivant les régions, Bufo bufo hiverne d’octobre à mars dans une cavité à l’abri du gel (tunnel d’animal, cave, tas de bois).
Suivant les régions, Bufo bufo hiverne d’octobre à mars dans une cavité à l’abri du gel (tunnel d’animal, cave, tas de bois).La sortie d’hibernation et la migration vers la zone de ponte commencent dès que la température atteint 5°C au coucher du soleil avec une humidité relative de 60% environ. Il semble qu’une durée de nuit inférieure à treize heures soit également nécessaire. La femelle sort généralement plus tard que le mâle.
La saison peut durer de un à deux mois ; début au plus tôt en février et fin au plus tard à mi-avril.
 et en lisière de forêt. Ils drainent les crapauds dispersés dans un rayon de 1 km (parfois jusqu’à 3 km). Des dizaines, des centaines, voire des milliers d’individus se regroupent.
et en lisière de forêt. Ils drainent les crapauds dispersés dans un rayon de 1 km (parfois jusqu’à 3 km). Des dizaines, des centaines, voire des milliers d’individus se regroupent.En conséquence, la colonisation d’un nouvel endroit est très lente et si une population est éliminée, il faut longtemps pour qu’elle soit remplacée.
Les « mains » du mâle sont enfoncées dans les aisselles de la femelle. Les callosités nuptiales présentes sur trois de ses doigts et très foncées pendant la saison de reproduction, l’aident à maintenir sa prise.
Il n’est pas rare de voir plusieurs mâles s’agripper autour de la même femelle.
 L’accouplement peut durer des heures, le mâle chevauchant la femelle souvent bien avant d’atteindre l’eau. Son instinct de reproduction l’amène à s’accrocher à tout ce qui bouge (grenouille, poisson, autre mâle) et à ne lâcher prise parfois que plusieurs jours après.
L’accouplement peut durer des heures, le mâle chevauchant la femelle souvent bien avant d’atteindre l’eau. Son instinct de reproduction l’amène à s’accrocher à tout ce qui bouge (grenouille, poisson, autre mâle) et à ne lâcher prise parfois que plusieurs jours après.Quand la femelle est prête à pondre, le mâle commence à lui caresser les flancs.
La ponte se présente sous la forme de deux longs cordons contenant trois ou quatre rangées d’œufs. Le mâle les saisit, les attache à une tige de plante et féconde les œufs au fur et à mesure.
 Son intervention est déterminante dans le développement ultérieur des œufs : si la ponte tombe dans la vase ou au fond de la mare, moins d’œufs arriveront à maturité ; de même l’étirement du cordon (œufs en deux rangées plutôt que trois ou quatre) améliore le taux de réussite.
Son intervention est déterminante dans le développement ultérieur des œufs : si la ponte tombe dans la vase ou au fond de la mare, moins d’œufs arriveront à maturité ; de même l’étirement du cordon (œufs en deux rangées plutôt que trois ou quatre) améliore le taux de réussite.La femelle quitte le lieu de reproduction dès qu’elle a pondu, tandis que le mâle y séjourne plusieurs jours (ce qui pourrait expliquer en partie le nombre plus grand de mâles que de femelles).
Ils se dispersent ensuite vers les sites de séjour du printemps et de l’été.L’œuf est un petit embryon noir dans une enveloppe transparente. Il mesure environ 2 mm de diamètre. Son incubation dure de 21 à 28 jours.
 A l’éclosion, le têtard mesure entre 3 et 5 mm de long (il est parmi les plus petits des anoures). Il est de couleur noirâtre avec des petites taches marron. Sa petite queue à l’extrémité arrondie, ne se prolonge pas sur le dos. Ses yeux sont assez rapprochés.
A l’éclosion, le têtard mesure entre 3 et 5 mm de long (il est parmi les plus petits des anoures). Il est de couleur noirâtre avec des petites taches marron. Sa petite queue à l’extrémité arrondie, ne se prolonge pas sur le dos. Ses yeux sont assez rapprochés.Il grandit jusqu’à une longueur de 40 mm.Les hormones thyroïdiennes commandent sa métamorphose en « crapelet ».
Métamorphose qui sera achevée en juillet quand les poumons prennent le relais des branchies et qu’il quitte la mare (taille de 7 à 12 mm). Cette sortie s’effectue en grand nombre et les crapelets se cachent dans les fissures, la vase, les pierres ou la végétation en attendant les températures douces ou la pluie pour s’éloigner de l’eau.
Ma maturité est atteinte à 3 ans chez les mâles et 4 ans chez les femelles.
Des études semblent indiquer que la taille du corps serait un facteur plus important que l’âge dans le déterminisme de la maturité sexuelle.
En captivité, il peut vivre 36 ans.
Remarque : en zone méditerranéenne, Bufo bufo se reproduit aussi en automne. Cependant, les spécimens méditerranéens ne se reproduisent pas tous les ans.Qui le menace ou l’importune (en plus des hommes…)
 Ses prédateurs principaux sont certains oiseaux comme les buses et les hérons, la couleuvre vipérine, la couleuvre à collier, et des mammifères comme les blaireaux.
Ses prédateurs principaux sont certains oiseaux comme les buses et les hérons, la couleuvre vipérine, la couleuvre à collier, et des mammifères comme les blaireaux.Ces derniers le dévorent par le ventre, évitant ainsi le contact avec les glandes toxiques.
Un chien attrapant sans cette précaution un crapaud, le lâche et sa gueule présente une écume blanche (heureusement, pas de réelle blessure).
Le hérisson supporte le venin qu’il utilise pour enduire ses piquants.
Après avoir tué leur hôte, elles se métamorphosent et s’échappent du cadavre de l’amphibien.Le têtard du crapaud commun est toxique pour les poissons.
Le chant du mâle est faible car il n’a pas de sac vocal. C’est un appel lent qui ressemble à: « oeck…oeck…oeck… ». S’il est plus rapide (environ 3 fois par seconde) : c’est un appel de détresse.
La femelle est muette.
En présence d’un ennemi naturel, il se dresse sur ses pattes, se gonfle et baisse la tête pour paraître plus gros et décourager le prédateur.
S’il est touché ou soulevé, il excrète de l’urine.
 Sans oublier l’action des deux glandes parotoïdes...
Sans oublier l’action des deux glandes parotoïdes...Elles sécrètent un poison dont les principes actifs sont la bufonine et la bufotaline.
Ce liquide blanchâtre irritant sert de défense contre les ennemis potentiels.
Inoffensif pour l’homme… cependant une simple manipulation du crapaud commun peut provoquer des irritations si les mains sont portées à la bouche ou aux yeux (il n’est efficace qu’en contact avec les muqueuses).
Peut aussi être nocif si la peau est lésée (blessures ouvertes)
Un têtard blessé dégage dans l’eau une substance qui permet d’avertir les autres d’un possible danger.
Il se déplace d’habitude en marchant. S’il se sent en danger, il saute.Respiration
Le crapaud commun ne possède pas de côtes lui permettant de dilater et de contracter ses poumons. C’est en levant et en abaissant régulièrement le plancher buccal, qu’il aspire l’air par ses narines et le fait refluer vers ses poumons (comme s’il avalait l’air).
Ce système est insuffisant pour assurer tous les échanges gazeux nécessaires. Sa peau lui permet de compléter ces échanges : l’oxygène de l’air se dissout dans la mince couche de mucus et est absorbé directement par le sang qui circule dans les vaisseaux sous-cutanés.Boisson
Autre particularité de sa peau : elle lui permet d’absorber l’eau dont il a besoin car il ne boit pas par la bouche.Territorialité
Le crapaud ne défend pas de territoire.

 Comme la plupart des amphibiens, il est menacé par la destruction et l’assèchement des marais et des milieux humides, et par les pesticides.Beaucoup de crapauds communs sont écrasés sur les routes en rejoignant leur zone de reproduction. En de nombreux endroits, les routes ont été creusées pour mettre en place des buses de ciment : les crapauducs.
Comme la plupart des amphibiens, il est menacé par la destruction et l’assèchement des marais et des milieux humides, et par les pesticides.Beaucoup de crapauds communs sont écrasés sur les routes en rejoignant leur zone de reproduction. En de nombreux endroits, les routes ont été creusées pour mettre en place des buses de ciment : les crapauducs.Elles servent aux crapauds pour traverser sans danger.
On utilise aussi des barrières temporaires : une bâche plastique disposée verticalement et supportée par une corde tendue entre des piquets.
Les seaux sont visités matin et soir, et les individus collectés transférés de l’autre côté de la route.
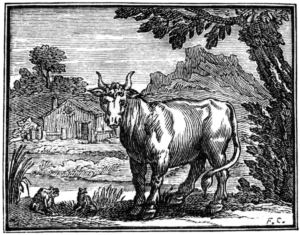
Mais on ne va pas réécrire ici les Fables de La Fontaine !!!
 De portée nationale :
De portée nationale :
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 3
Loi relative à la protection de la nature du 13 juillet 1976 : interdiction sur le territoire national et en tout temps de détruire ou d’enlever les œufs ou les nids, de détruire, de mutiler, de capturer, de naturaliser ou d’enlever qu’il soit vivant ou mort, de colporter, d’utiliser, de commercialiser Bufo bufo.
 Enfin, une remarque technico-cocasse…
Enfin, une remarque technico-cocasse…
Un des engins manuels les plus utilisés par les carriers était un treuil mécanique à base d’engrenages composant une démultiplication et déployant une force de traction considérable pour traîner des blocs de 2 tonnes ou plus, soit en les ripant sur du craon soit en les halant sur des « roules » placés sous les blocs.
Ce treuil sur roues d’acier était arrimé en arrière grâce à une forte chaîne bloquée sur un gros piquet d’acier ou passée au travers d’une arête de pilier tourné ou d’un angle de roche encore en masse.
Vers l’avant une autre chaîne était elle aussi passée à travers un angle du bloc à déplacer
Et ce treuil monté sur trois roues, bien stable, d’allure râblée, s’appelait un « Crapaud » ! Fin XIXème siècle.
La chaîne utilisée était très massive, faite de maillons en fil d’acier de 2 cm de diamètre et 6 cm de longueur….d’où une chaîne pesant environ 6 à 7 kg au mètre ! Compte tenu de la qualité de l’acier brut de l’époque, ça pouvait résister à plus de 10 tonnes…
(NDLR : De nos jours, une chaîne de ce calibre tient plus de 20 tonnes, si elle est sortie d’une aciérie sérieuse)
